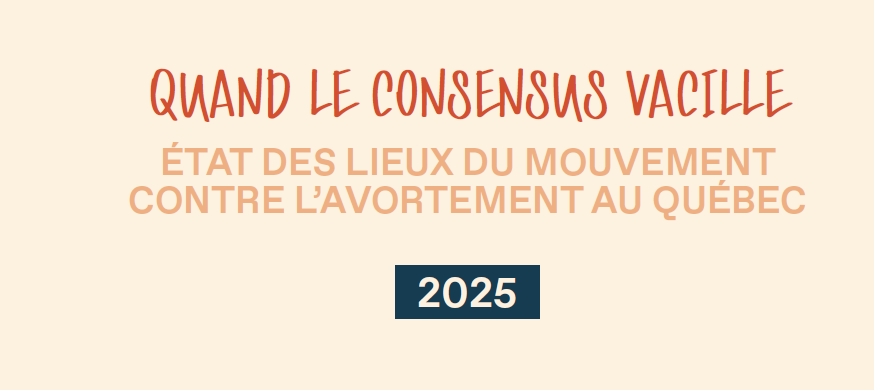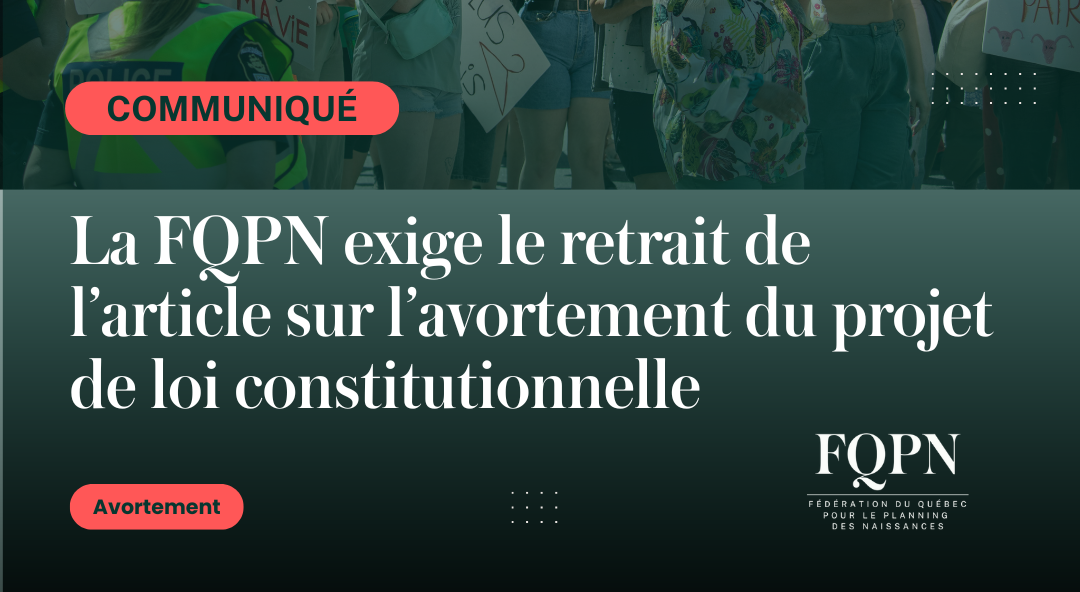Depuis que SisterSong a introduit le terme « justice reproductive » à l’occasion de sa première conférence nationale en novembre 2003, l’expression a fait son chemin au sein du mouvement pour les droits reproductifs et a peu à peu rejoint les militant.e.s, les bailleurs de fonds, les chercheur.e.s, les universitaires et ceux et celles qui défendent cette cause. Plusieurs personnes, groupes et organisations trouvent le terme utile, car il permet d’aller au-delà de l’enjeu de l’avortement qui tend à prendre toute la place dans le mouvement pro-choix. Ceux et celles qui œuvrent dans d’autres mouvements en faveur de la justice sociale trouvent aussi le concept utile car il leur permet d’intégrer les enjeux de santé reproductive à leurs analyses même si leur mission première n’est pas en lien avec les droits des femmes. La justice reproductive permet aussi de mettre en relation les groupes qui travaillent sur les droits sexuels et les questions de genre et d’identité avec ceux qui travaillent sur les enjeux reproductifs. Une recherche du terme « justice reproductive » effectuée sur Google en novembre 2006 a donné 76 000 résultats, preuve de la grande acceptation et de l’utilité de ce terme créé à l’origine en 1994 par des femmes Africaines-américaines à la suite de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement qui a eu lieu au Caire, en Égypte. Selon Marlene Fried du Civil Liberties and Public Policy Program du Collège Hampshire, la justice reproductive fournit un cadre politique pour un ensemble d’idées, d’aspirations et de visions, avec une perspective qui tient compte des enjeux de justice sociale et de droits humains.
À cause de la popularité et de la viabilité du terme Justice Reproductive, ou JR, comme nous l’appelons, SisterSong souhaite que ceux et celles qui l’utilisent le fassent librement mais en comprenant ce qu’il signifie pour nous. Car il ne s’agit pas d’un banal substitut aux termes « pro-choix », « droits reproductifs » ou même « droits sexuels ». Bien que nous soyons encouragées par la vitesse à laquelle le terme a été adopté et adapté par plusieurs allié.e.s au sein de nos mouvements, nous espérons que ceux et celles qui l’emploient en comprennent totalement la portée, la profondeur et la force.
La Justice Reproductive est, en fait, un changement de paradigme qui va au-delà des revendications d’égalité de genres ou même de l’inclusion du droit à l’avortement dans une perspective plus large en santé reproductive. Tous ces concepts sont en fait inclus dans le cadre de la Justice Reproductive. La JR est la continuité de la théorie intersectionnelle développée par les femmes racisées et de la pratique du self-help développée dans le mouvement pour la santé des femmes Africaines-américaines, appliquées au mouvement pour les droits reproductifs. Elle est fondée sur un cadre d’analyse basé sur les droits humains aux États-Unis. La Justice Reproductive est dans son essence même une théorie intersectionnelle qui prend son origine dans les expériences des femmes racisées dont les multiples communautés vivent un amalgame complexe d’oppressions reproductives. Elle est basée sur la compréhension que les impacts des oppressions liées à la race, à la classe, au genre ou à l’identité sexuelle ne s’additionnent pas mais s’entrecroisent, créant ce paradigme d’intersectionnalité (à l’intersection des oppressions. NDLT). Ainsi, pour chaque individu et chaque communauté, les effets (des multiples oppressions) sont différents mais partagent certaines caractéristiques de l’intersectionnalité : l’universalité, la simultanéité et l’interdépendance.
La justice reproductive est une approche positive qui relie la sexualité, la santé et les droits humains aux mouvements pour la justice sociale en plaçant l’avortement et les enjeux de santé reproductive dans le contexte plus large du bien-être et de la santé des femmes, des familles et des communautés. Elle intègre naturellement les droits humains individuels et collectifs, droits qui sont particulièrement importants pour les communautés marginalisées. Nous croyons que la capacité d’une femme à déterminer sa vie reproductive est directement liée aux conditions dans lesquelles vit sa communauté et n’est pas uniquement une question de choix personnel et d’accessibilité. Si une femme fait partie d’une communauté dont les droits humains ne sont pas respectés, par la présence de dangers environnementaux ou le manque d’accès à des soins de santé de qualité, par exemple, ses décisions par rapport à son corps ne pourront être prises sur des bases strictement individuelles. La justice reproductive aborde les enjeux du contrôle des populations, de l’autodétermination des corps, des droits des immigrant.e.s, de la justice économique et environnementale, de la souveraineté, du militarisme et des injustices criminelles parce que ces oppressions dirigées envers un groupe ou une communauté limitent les droits humains individuels.
Le terme justice reproductive ne remplace pas le vocabulaire utilisé au sein de notre mouvement, mais nous invite à réexaminer les enjeux reproductifs à travers le cadre des droits des femmes et des droits humains. La justice reproductive est à la fois une nouvelle théorie, une nouvelle pratique et une nouvelle stratégie. Elle nous a donné un langage commun et une base d’unité plus large pour notre mouvement. Pour que ce processus positif continue, nous croyons que notre mouvement doit partager une compréhension approfondie de ce cadre d’analyse et de sa capacité potentielle à dépasser les débats figés sur l’avortement dès que l’on aborde les questions de santé reproductive.
La théorie de la justice reproductive a été créée parce que nous, les femmes racisées, cherchions un moyen d’exprimer les besoins de nos communautés. Les trois principes fondamentaux de la justice reproductive développés par SisterSong depuis notre création en 1997 sont le résultat de l’apprentissage et du partage collectif, autant théorique que pratique. Nous croyons que chaque femme a le droit fondamental de :
– Décider si et quand elle aura un enfant et de décider des conditions de son accouchement
– Décider de ne pas avoir d’enfant et d’avoir le choix de prévenir ou de terminer une grossesse
– Élever le ou les enfants qu’elle a déjà avec un support social adéquat, dans des environnements sécuritaires et dans des communautés saines, sans craindre d’être victime de violence de la part d’individus ou du gouvernement.
En résumé, la justice reproductive est un cadre d’analyse intersectionnel enchâssé dans le cadre des droits humains qui s’applique à toutes et tous et qui est basé sur les concepts de l’intersectionnalité et la pratique du self- help, dont nous parlerons plus loin. C’est aussi une stratégie utilisée pour renforcer notre mouvement par la base en intégrant des enjeux multiples et des collaborations intersectorielles. La justice reproductive permet aussi d’intégrer dans nos perspectives les violations des droits humains qui rendent difficile le contrôle de nos corps et de la destinée de nos familles et de nos communautés. C’est ce que l’on nomme les « oppressions reproductives ».
Au cœur du problème : l’oppression reproductive
L’oppression reproductive est le contrôle et l’exploitation des femmes, des filles et des individus à travers nos corps, notre sexualité, notre travail et notre reproduction. Le contrôle des femmes et des individus devient ainsi un moyen stratégique pour contrôler des communautés entières. Cette logique s’appuie sur des systèmes d’oppression basés sur la race, la capacité, la classe, le genre, la sexualité, l’âge ou le statut migratoire. (Asian Communities for Reproductive Justice – ACRJ)
Les femmes racisées ont vécu et vivent encore aujourd’hui des « punitions reproductives » telles que décrites par Dorothy Roberts, ou des « oppressions reproductives » telles que définies par l’ACRJ. Ces deux termes résument bien la manière dont l’État et autres types d’organisations refusent de nous soutenir avec des services de qualité et des ressources, tout en s’immisçant dans nos vies et nos décisions. L’oppression reproductive se manifeste, par exemple, à travers des mesures discriminatoires de placement des enfants à l’extérieur de leurs familles, à travers la criminalisation de la grossesse, les restrictions à l’immigration, l’interdiction pour les personnes LGBTQ d’avoir des enfants ainsi que les avortements forcés pour les femmes incarcérées. Comme il est mentionné plus haut, l’oppression reproductive est un moyen d’effectuer un contrôle sélectif sur la destinée de communautés entières à travers le corps des femmes et des individus, ce qui représente une forme nouvelle et plus subtile d’eugénisme négatif. En fait, selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide des Nations Unies, l’oppression reproductive correspond aux critères qui définissent un génocide, car elle peut être définie comme « l’imposition de mesures visant à entraver les naissances au sein d’un groupe, et au transfert forcé d’enfants dans un autre groupe ». En tant que société, nous pouvons débattre éternellement de la question de l’intention ou du résultat. Mais le fait demeure que nous, femmes racisées- et nos enfants- faisons face à des politiques reproductives oppressives de la part d’acteurs étatiques et non-étatiques qui ont des conséquences néfastes sur nos vies.
Il est également important de comprendre comment la suprématie blanche et le racisme systémique aux États-Unis facilitent l’oppression reproductive, un aspect qui est minimisé par le mouvement pro-choix mainstream. Le concept de justice reproductive fonctionne de manière similaire pour les femmes blanches, car leurs décisions individuelles sont aussi reliées directement à leurs communautés. Un exemple en est la crainte raciste engendrée par la diminution des naissances d’enfants blancs aux États-Unis. Bon nombre des restrictions liées à l’avortement, la contraception, l’éducation sexuelle scientifiquement pertinente et la recherche sur les cellules souches sont directement reliées à une campagne peu subtile d’eugénisme positif pour forcer les femmes blanches hétérosexuelles à avoir plus d’enfants. Parallèlement à cela, les enfants racisés sont souvent considérés comme indésirables, trop nombreux et sont perçus comme une menace à l’entité politique que sont les États-Unis. Ils sont décrits comme une classe marginale et criminelle, comme une « explosion démographique » engendrant un système d’éducation dysfonctionnel, le chaos économique et la dégradation environnementale.
La séparation de la question de l’avortement par rapport aux autres enjeux sociaux qui affectent nos diverses communautés est une manière de contribuer à l’oppression reproductive, plutôt que d’aller à son encontre. La question de l’avortement, lorsqu’elle est dissociée des autres enjeux de justice sociale et de droits humains, ne tient pas compte des questions de justice économique, d’environnement, de justice criminelle, de droits des immigrant.e.s, de militarisme, de discrimination basée sur la race et l’identité sexuelle, et de toute une série d’autres enjeux qui affectent pourtant directement le processus décisionnel des femmes. Il est aussi préoccupant que la défense du droit à l’avortement soit souvent isolée des autres enjeux de santé reproductive, au lieu d’être considérée comme faisant partie d’un continuum englobant les expériences en santé reproductive vécues par les femmes et faisant partie de leurs droits humains fondamentaux.
Nous devons en finir avec la séparation du droit à l’avortement des autres enjeux de justice sociale, de droits reproductifs et de droits humains. Car il est difficile, voire impossible, de mobiliser des communautés en faveur du droit à l’avortement si celui-ci est considéré hors du contexte de l’émancipation des femmes et de la promotion de familles et de communautés en santé. Avec la Justice reproductive, Sistersong modifie la définition du problème, qui devient celui de l’oppression reproductive plutôt que celui droit singulier à l’avortement. Ce faisant, nous offrons une nouvelle avenue, plus inclusive et rassembleuse afin de construire ensemble un nouveau mouvement de défense des droits des femmes.
Afin de mieux comprendre comment SisterSong souhaite que l’approche de la justice reproductive soit articulée avec le cadre analytique des droits humains, il est important de réviser les huit catégories actuelles de droits humains afin d’avoir une idée de leur importance dans la vie de tous et toutes.
Ces catégories ont été développées et raffinées depuis la rédaction de la Déclaration universelle des droits humains en 1948.
Les 8 catégories de droits humains
- Droits civils – non-discrimination, égalité
- Droits politiques – vote, parole, assemblée
- Droits économiques – salaire décent, droits des travailleurs et travailleuses
- Droits sociaux – santé, nourriture, logement, éducation
- Droits culturels – religion, langue, habillement
- Droits environnementaux – eau et air purs, terre non-polluée. Pas de voisinage toxique.
- Droits au développement – contrôler ses propres ressources naturelles
- Droits sexuels – droit d’avoir ou non des enfants, droit de se marier ou non et de choisir quand se marier, les droits des homosexuels et des trans*, le droit à la contraception et à l’avortement, le droit au plaisir sexuel et le droit de définir soi-même sa notion de famille.
Il est important de comprendre que les allégations abusives concernant les « droits de l’enfant à naître » (en violation de la Déclaration universelle des droits humains) sont utilisées par ceux et celles qui manipulent ce cadre d’analyse plutôt que par ceux et celles qui le défendent. Cette stratégie vise à nous priver de nos droits humains tels que le droit à la vie privée, à l’autodétermination corporelle et à la justice, mais s’attaque tout spécialement aux droits des femmes. En fait, le premier article de la DUDH affirme que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits [souligné ici] ». La DUDH ne confère pas de droits humains à celles et ceux qui ne sont pas encore nés, mais exige que les droits de ceux et celles qui sont déjà nés soient respectés et protégés. Les droits humains ne sont pas négociables : ils sont inaliénables. En tant que personnes, nos droits humains sont fondamentaux. Afin que soient respectés nos droits humains, nous cherchons à atteindre la justice reproductive pour nous-mêmes, pour nos familles et pour nos communautés.
Trois cadres de travail pour notre action militante
La justice reproductive est le total bien-être des femmes et des filles sur le plan physique, mental, spirituel, politique, social et économique. Elle est fondée sur la pleine réalisation et la protection de leurs droits humains. (Asian Communities for Reproductive Justice)
Dans son document de réflexion de 2005, le groupe Asian Communities for Reproductive Justice a développé l’analyse originale de SisterSong en évaluant quel sont les trois axes principaux pour combattre l’oppression reproductive : 1)La santé reproductive, qui travaille sur l’accès aux services, 2)Le droit reproductif, qui travaille sur l’aspect légal, 3)La justice reproductive qui travaille sur la création et le renforcement d’un mouvement (Voir le texte de l’ACRJ « A new vision for reproductive justice » ici). Ces trois axes constituent des réponses complémentaires et exhaustives à l’oppression reproductive, en plus d’offrir une vision proactive qui exprime clairement ce pour quoi nous nous battons ainsi que la manière de construire un nouveau mouvement pour faire avancer les droits des femmes.
L’approche en Santé Reproductive se préoccupe de l’accessibilité des services afin de répondre aux besoins des femmes en matière de santé reproductive. Elle met l’accent sur le manque de soins de santé, de services, d’information ainsi que sur les lacunes de la recherche en santé. Ses buts sont d’améliorer les services, la recherche et l’accessibilité, particulièrement en matière de prévention, et de fournir des soins culturellement adaptés pour les communautés racisées.
L’approche en Droit Reproductif utilise le lobbying et la défense légale afin de protéger le droit des femmes à avoir des services en santé reproductive. Son objectif est de mettre en place des protections légales ou de s’assurer que sont respectées et appliquées les lois destinées à protéger le droit individuel d’une femme à obtenir des soins en santé reproductive. Le but est d’obtenir une protection légale et universelle pour toutes et que ces protections soient reconnues comme des droits constitutionnels.
L’approche en Justice Reproductive s’inscrit dans un cadre d’analyse et de pratique visant à créer un mouvement qui reconnait que l’oppression reproductive est le résultat de l’intersection de multiples oppressions et est intimement lié à la lutte pour la justice sociale et les droits humains. Elle reconnait que les institutions sociales, l’environnement, l’économie et la culture affectent la vie reproductive des femmes.
Chacune de ces approches possède ses forces et ses limites, mais ensemble elles forment le cœur de l’action militante de notre mouvement. La justice reproductive nécessite une analyse intégrée, une vision holistique ainsi qu’une stratégie globale pour faire pression sur les conditions structurelles et sociétales qui contrôlent nos communautés en réglementant nos corps, notre sexualité, notre travail et notre reproduction. Elle demande que ceux et celles qui œuvrent dans les mouvements en faveur de la justice sociale travaillent ensemble à faire respecter les droits humains universels.
La justice reproductive nous permet de poursuivre le rêve d’un monde qui nous protégera et nous offrira un bien-être total sur le plan physique, mental, spirituel, politique, économique et social. Afin de passer à l’acte, nous devons former de nouvelles et nouveaux leaders, organiser nos jeunes et éduquer les leaders de nos communautés.
La Justice Reproductive devient une réalité lorsque les femmes, les filles et les individus ont le pouvoir social, économique et politique ainsi que les ressources nécessaires pour prendre les décisions les plus saines concernant leurs corps, leur sexualité et leur reproduction. Pour nous, pour nos familles et pour nos communautés.– Asian Communities for Reproductive Justice
Pourquoi avons-nous besoin d’une nouvelle approche ?
La justice reproductive est une réponse aux lacunes du mouvement « pro-choix ». Il existe huit limites importantes au concept de choix, auxquelles remédie le cadre de la justice reproductive, selon Marlene Fried :
- Le concept de choix ne tient pas compte de la complexité de la vie des femmes. Il ne tient pas compte des questions d’accès- ou de manque d’accès- et néglige le contexte particulier de chaque femme. Ce n’est pas parce qu’une femme cherche à avorter qu’elle est uniquement concernée par ce droit. Plus souvent qu’autrement, les femmes sont simultanément confrontées à divers enjeux relevant des droits humains.
- Le concept de choix ne tient pas compte du contrôle des populations. Le choix en matière de reproduction aux États-Unis se limite au droit de ne pas avoir d’enfant, mais n’aborde pas la question du droit des femmes d’avoir autant d’enfants qu’elles le souhaitent.
- La notion de « choix » est un concept conservateur sur le plan politique. Dans les années 1970, dans le but de lutter contre les politiques conservatrices, le mouvement a fait du terme « choix » un concept libertarien antigouvernemental qui était attrayant pour une partie de la population, mais qui reléguait à l’arrière-plan les droits des femmes, les droits sexuels, le droit au plaisir sexuel et la simple notion que les femmes étaient capables de prendre des décisions éclairées.
- Le concept de « choix » est consumériste et commercial. L’avortement est un droit reproductif qui est uniquement accessible pour celles qui peuvent se le permettre financièrement. Le marché privatise l’obligation gouvernement non seulement de protéger le choix, mais d’assurer que ces choix sont réalisables pour toutes.
- Le « choix » est un concept individuel qui ne tient pas compte des problèmes sociaux qui empêchent les femmes d’exercer leurs droits. Les grossesses non planifiées et la pauvreté ne sont pas des problèmes individuels.
- Le terme « choix » est surtout parlant pour celles qui ont conscience qu’elles peuvent faire des choix dans d’autres sphères de leurs vies, celles dont les droits humains sont moins à risque d’être violés.
- Le « choix » n’est pas un argument moral suffisamment fort, particulièrement lorsqu’on fait face à une argumentation en faveur de « la vie » de la part de ceux et celles qui s’opposent aux droits des femmes.
- Le « choix » n’est pas un objectif convaincant. Cet argument n’est pas suffisant pour mobiliser le type de mouvement nécessaire pour réaliser de grandes avancées sociales.
Le mouvement pro-choix est profondément démoralisé; à cause des attaques incessantes contre les services, le financement le personnel médical mais aussi contre les femmes qui cherchent à se faire avorter.
Le milieu qui offre les possibilités de croissance les plus excitantes pour notre mouvement est la nouvelle génération militante, attirée par l’approche de la justice reproductive et par le puissant leadership des femmes racisées au sein de ce mouvement.
Le futur de notre mouvement pour la Justice Reproductive
À SisterSong, nous pensons que notre conception de la justice reproductive offre un cadre d’analyse et de pratique convaincant et plus adapté afin de renforcer le pouvoir d’agir des femmes et des individus, dans le but de créer des familles et des communautés plus saines et plus fortes. Ceci est un message clair pour le mouvement pro-choix.Nous pensons que, collectivement, nous avons le potentiel nécessaire pour remotiver un mouvement pro-choix clairement découragé; en apportant de nouvelles voix pour élargir notre base; en reformulant notre vision et en étant en lien avec d’autres mouvements œuvrant pour la justice sociale. Le concept de Justice Reproductive aide à repositionner le débat public sur la santé reproductive qui est dominé par la question de l’avortement et permet de le ramener à des enjeux plus larges de santé reproductive, de droits et de justice. En utilisant cette notion, nous pouvons intégrer différents enjeux et amener à collaborer des groupes multiraciaux, multi-générationnels et issus de toutes les classes sociales dans le but de bâtir un puissant mouvement grassroot capable de générer des changements sociaux systémiques.
Un exemple d’action concrète inspirée du cadre d’analyse de la justice reproductive est la « March for Women’s Lives » qui a eu lieu le 25 avril 2004 et a réuni plus de 1,15 million de personnes, ce qui en fait la plus grande manifestation de l’histoire des États-Unis. « La « March for Women’s Lives » est exemple parfait de comment la justice reproductive permet de créer un mouvement plus large», affirme Kathy Spillar, vice-présidente de Feminist Majority Foundation , une des premières organisations à avoir mobilisé les gens et fourni des ressources, du personnel et un lieu de travail pour l’organisation de la marche. Spillar s’est exprimée lors du « Funders’ Briefing on Reproductive Justice (réunion des bailleurs de fonds pour la Justice Reproductive) » que SisterSong a organisé en octobre 2005. Les organisatrices de la marche ont établi des liens entre les attaques contre l’avortement au pays et la loi du silence au niveau mondial, la propagation du VIH/SIDA à cause d’une éducation sexuelle erronée qui promeut uniquement l’abstinence, la crise de la dette qui appauvrit les pays en développement, la guerre contre l’Irak, les atteintes à la vie privée et aux droits des citoyens et citoyennes, les attaques contre le mariage homosexuel, le mépris des organismes internationaux comme les Nations Unies ou les traités des droits humains, ou nos institutions politiques biaisées qui font que les présidents sont « sélectionnés » plutôt que réellement élus dans un système qui refuse la démocratie directe. Le succès de la Marche est une démonstration de la capacité du mouvement pour les droits humains à mobiliser et à unifier divers secteurs du mouvement pour la justice sociale dans le but de soutenir les droits des femmes aux États-Unis et à l’étranger. En résumé, la marche a démontré que l’utilisation du cadre d’analyse de la justice reproductive était une stratégie gagnante.
Nous nous trouvons à un moment critique pour examiner l’orientation future du mouvement pro-choix. En effet, la vague de conservatisme politique extrême qui s’abat sur la nation a des conséquences de plus en plus sérieuses pour les femmes et affecte les politiques en santé sexuelle et reproductive à tous les niveaux, du président des États-Unis jusqu’à la Cour suprême, de la législature des états aux administrations des écoles en passant par la politique étrangère. De plus, les affronts aux droits civils et humains des communautés racisées et des personnes marginalisées se multiplient dans un climat politique en rapide transformation. C’est pourquoi nous trouvons essentiel d’utiliser le cadre de la justice reproductive pour unir les femmes et leurs communautés, pour avoir une action pertinente pour les communautés racisées et pour unir les revendications de ceux et celles qui agissent à différents niveaux, du Capitole au groupe de mobilisation local; tout ceci afin de développer des stratégies proactives pour protéger et préserver nos vies.
La portée de cet article ne permet pas de discuter en détail des techniques de self-help que SisterSong emploie dans son application du cadre de la justice reproductive ni ne permet d’expliciter nos méthodes pour créer l’unité au sein de notre Collective. Les techniques du self-help sont décrites en détail dans le livre « Undivided Rights : Women of Color Organize for Reproductive Justice » publié en 2004 par South End Press. Par contre, il est primordial de mentionner que la justice reproductive requiert un processus à travers lequel les différences entre les femmes et les individus peuvent être transcendées afin de bâtir un mouvement pour la justice reproductive unifié. Le self-help permet d’aborder les enjeux d’oppression intériorisée et d’émancipation qui doivent absolument être confrontés lorsque des personnes aux appartenances différentes -qu’elles soient basées sur la race, la classe, l’âge, l’ethnicité, la religion, l’identité sexuelle, l’identité de genre, le handicap ou le statut d’immigrant- travaillent ensemble. Travailler simultanément sur une diversité d’enjeux avec des partenaires de divers secteurs est extrêmement difficile si l’on n’a pas de processus fonctionnel pour maintenir l’unité tout en abordant la question complexe des oppressions intersectionnelles. Le cadre de la justice reproductive n’est pas complet et la compréhension qu’on en a n’est que partielle si on n’y incorpore pas les principes et pratiques du self-help établis dans les années 80 par le « National Black Women’s Health Project » et le « National Latina Health Organization ».
SisterSong offre des formations « Justice Reproductive 101 » aux organismes, aux groupes et aux individus qui souhaitent explorer la Justice Reproductive en profondeur et en apprendre plus sur les éléments qui la constituent tels que l’intersectionnalité, les droits humains, le self-help et l’empowerment. Pour réserver une formation, appelez-nous au 404-756-2680 ou écrivez-nous à Loretta@sistersong.net.
SisterSong offre cette formation afin de s’assurer que le concept de la Justice Reproductive n’est pas dénaturé lorsqu’il est approprié par d’autres ni manipulé afin de s’adapter à leurs propres besoins. Bien que nous ne puissions ni ne souhaitions empêcher quiconque d’utiliser ce terme, que l’on sait extrêmement attrayant, nous espérons malgré tout que la théorie qui est à la base de ce mouvement et les pratiques qui en découlent, dont l’origine est ancrée dans l’expérience des femmes racisées, seront respectées avec la même intégrité et la même générosité que celle dont nous faisons preuve en vous partageant nos perspectives.
©SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective- Novembre 2006 (Mis à jour en mars 2011)
Le texte original en Anglais est disponible ici. Nous l’avons traduit avec l’aimable autorisation de l’auteure.